Retour sur un livre précieux : Marx écologiste
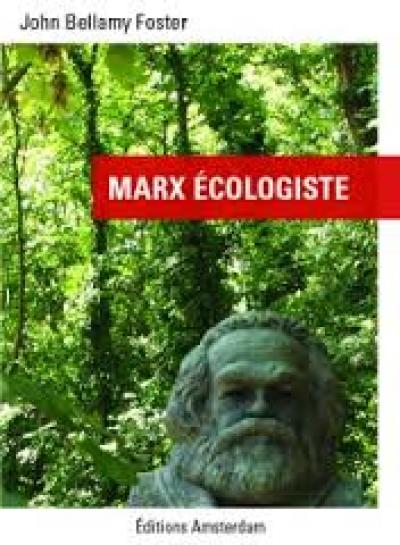
Plusieurs chemins sont proposés pour répondre à la crise environnementale : la seule adaptation technique, le parti pris de la pause, un repli sur soi vers une nature idéalisée. Bref, confier son avenir au développement sans fin du capitalisme, croire à l’illusion d’un possible immobilisme ou aspirer à un retour à l’« ancien temps ».
Comment dégager une voie progressiste au milieu de ce marasme intellectuel ? Dans ces temps de bouleversement, où le neuf éblouit, il importe de comprendre les causes des phénomènes observés, car on ne peut concevoir ce qui est sans avoir élucidé préalablement comment ce qui existe s’est formé. Pour cela, seule une analyse matérialiste de la question environnementale permet d’appréhender pleinement les phénomènes environnementaux en les réinsérant dans les rapports sociaux à l’œuvre.
Le livre de John Bellamy Foster, sociologue états-unien et directeur de la Monthly Review, intitulé Marx Écologiste, paru en 2011 aux éditions d’Amsterdam, est en ce sens précieux car il ouvre la voie à une telle réflexion en identifiant dans l’œuvre de Marx des analyses toujours d’actualité pour saisir la relation à l’environnement. En effet, alors que le marxisme est souvent associé à une modernité productiviste, le retour aux écrits de Marx permet d’y puiser une approche plus ouverte, tenant compte de la nécessité de préserver les sols et de penser les interactions entre les humains et la nature.
Préserver la fertilité des sols
Au cours du XIXe siècle, la diminution de la fertilité des sols par la perte de leurs nutriments constituait un problème agricole majeur. Pour y remédier, il fut d’abord fait appel à des engrais naturels, du guano péruvien et même les ossements des champs de bataille napoléoniens. Le développement de la science permit ensuite le développement des premiers intrants chimiques, marqueurs de la seconde révolution agricole. Marx, en fin analyste de son époque, lut avec attention les travaux du chimiste allemand Justus von Liebig qui expliquait le rôle des nutriments pour la terre et défendait l’importance de les restituer aux sols producteurs. Ainsi, Marx déplorait qu’ « à Londres, on n’a[it] trouvé rien de mieux à faire de l’engrais provenant de 4 millions et demi d’hommes que de s’en servir pour empester, à frais énormes, la Tamise » (Le Capital, Livre 3). Le développement de l’industrie et de l’agriculture poussait les hommes vers les villes, mais conduisait de fait à rompre « le métabolisme entre l’homme et la terre, c’est-à-dire le retour au sol des composantes de celui-ci usées par l’homme sous forme de nourriture et de vêtements, donc l’éternelle condition d’une fertilité durable du sol » (ibid., Livre 1). Marx concluait ainsi que « la production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du procès de production social qu’en ruinant dans le même temps les sources vives de toute richesse : la terre et le travailleur » (ibid., Livre 1). Or l’agriculture « doit mener sa production en tenant compte de l’ensemble des conditions d’existence permanentes des générations humaines qui se succèdent » (ibid., Livre 3).
Le métabolisme : la relation entre les humains et la nature
L’analyse de Marx est construite à l’appui du concept de « métabolisme » qui permet de décrire l’échange complexe et dynamique, résultant du travail humain, entre les êtres humains et la nature. Dans ses Manuscrits économico-philosophiques, Marx écrivait : « L’homme vit de la nature signifie : la nature est son corps propre, avec lequel il faut qu’il demeure dans un processus continu pour ne pas mourir. Le fait que la vie physique et spirituelle de l’homme soit dépendante de la nature, n’a d’autre sens que celui-ci : la nature est dépendante d’elle-même, car l’homme est une partie de la nature ». Le travail humain conduit donc à une appropriation de l’élément naturel en vue de la satisfaction des besoins humains, sans pour autant que cela signifie une réduction de la nature à la société, ni de la société à la nature. Comme le résume John Bellamy Foster, « les êtres humains font leur propre environnement, bien que selon des conditions qu’ils n’ont pas entièrement choisies, mais qui leur ont été transmises par la terre et par les générations antérieures, au cours d’une histoire simultanément naturelle et humaine ».
Cet article d'Ernest Simon est paru dans la revue Démocratie&Socialisme de février 2018 n°252
